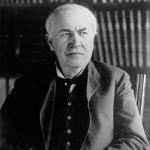Le burn-out : ce fléau (non encore) reconnu comme maladie professionnelle.
- Article d'Alain Astouric. Juillet 2019.
- D’après ENCADRER UNE ÉQUIPE et LE MANAGEMENT DURABLE ouvrages édités à la Chronique Sociale.

Le syndrome d’épuisement professionnel, également désigné par l’anglicisme burn-out, combine une fatigue profonde avec un sentiment d’échec et d’incompétence dans le travail. En France il fait des ravages : chaque mois des milliers de salariés, de tous niveaux, épuisés professionnellement voient leur énergie, leur motivation et leur estime de soi s’effondrer. Le burn-out est une véritable maladie professionnelle (non encore reconnue en France) d’un poids économique et social lourd pour la collectivité.
Comment en est-on arrivé là ?
Au début des années quatre-vingt-dix trois événements se sont mis en synergie.
- Tout d’abord la financiarisation des entreprises : travailler dans quelque domaine que ce soit, est devenu l’obligation d’obtenir avant tout des résultats financiers pour satisfaire des actionnaires ;
- Puis l’apparition du dogme de la mobilité : dans le secteur public comme comme dans celui privé un leitmotiv s’est imposé, il faut changer ! Ce qui est sain c’est de changer !
- Enfin le plaquage sans la moindre adaptation au mode de fonctionnement de la société française, de pratiques anglo-saxonne dont on savait depuis longtemps qu’elles n’ont de sens que dans leur contexte culturel d’origine. Par exemple la « Mutation organisationnelle permanente » qu’a connu en son temps France Télécom (devenu depuis Orange), au prix de plusieurs dizaines de suicides. Ou bien le travail en mode projet, qui fait de chaque Chef de projet un mini entrepreneur écartelé entre son besoin d’autonomie et son devoir de strict respect des procédures. Ou encore, les techniques de ré-ingénierie, qui multiplient les organigrammes en râteau exigeant d’un agent de maîtrise qu’il encadre jusqu’à quarante personnes sous la mensongère bannière : « Tous égaux et en réseau ».
On a là trois évolutions qui peuvent offrir quelques opportunités de responsabilisation des salariés et de mise en place d’organisations moins hiérarchiques, mais qui font surtout peser de graves risques sur la santé mentale des personnes au travail.
C’est donc au prétexte d’une impitoyable concurrence internationale qu’il n’est plus question, voire il est « mal vu » pour un encadrant, de chercher à donner du sens ; de communiquer utilement ; d’associer aux décisions ; de déléguer vraiment ; de respecter la parole donnée. Plus question non plus de valoriser, encourager, ni remercier … En conséquence de quoi les cadres se sont mis à « papillonner » en tentant de faire carrière aussi vite que possible, avant d’être vieux à 45 ans ! Pendant que les agents de maîtrise disparaissaient au bénéfice des procédures sensées tout prévoir (même les imprévus !?) et que les opérateurs se débrouillaient de cette nouvelle situation. Y compris, si nécessaire, en trichant d’une façon ou d’une autre ou simplement en augmentant leur absentéisme.
Briser l’identité professionnelle
Mais au bout d’un temps tout individu placé dans un tel étau ne peut que s’interroger sur son savoir-être, sa relation aux autres, son identité. Il risque alors de s’inventer une culpabilité personnelle à propos de sa supposé incompétence, à propos de ses prétendues carences professionnelles. Pour peu qu’intervienne à ce moment là un tournant de carrière tel qu’une perte de responsabilité, une mutation forcée, un changement d’équipe ou de métier ou simplement un entretien de recadrage lors duquel le salarié est « malmené », l’univers de reconnaissance professionnelle et d’estime de soi dans lequel il tentait de se reconstruire s’effondre brutalement, avec les drames humains que l’on sait. En somme la religion de la mobilité et le culte du changement sont une rupture supplémentaire dans un monde du travail maintenant vécu sans trop de perspectives, par des salariés se rendant compte de plus en plus tôt que « Ça ne vaut pas le coup de s’investir plus à fond pour si peu de reconnaissance dans une entreprise en la parole de laquelle on ne peut même plus avoir confiance ».
Une situation couramment dénoncées, à l’époque déjà mais dans l’indifférence politique quasi-totale, par de nombreux praticiens de terrain (psychologues, médecins et inspecteurs du travail, assistants sociaux), ainsi que par les syndicats et les Comités d’hygiène, sécurité. On a alors vécu là un silence anormalement inquiétant, et même franchement irresponsable. Surtout lorsque les entreprises ont fait en sorte que les gestionnaires se glissent un peu partout dans le paysage avec l’idée que l’on peut aussi faire des économies sur les stocks, sur les ratés, sur les retouches, sur les effectifs. Nous soutenant fermement, et bien souvent avec morgue, que la source essentielle de la richesse résidait au moins autant dans la gestion des stocks et celle des ressources humaines, que dans le travail lui-même. Soutenant aussi, et avec arrogance, que face à la rude concurrence internationale le seul salut possible passait par les « coûts à résorber », les « sureffectifs à éponger », les « postes à supprimer », les « mutations d’office à multiplier ». Et faisant petit à petit de nos entreprises, et autres structures, une jungle de plus en plus oppressante doublée d’un terrain en mutation continue exigeant un salarié en permanence performant, compétitif … Somme toute, un collaborateur voué à devenir la victime expiatoire du syndrome d’épuisement professionnel !
En réalité depuis plus de vingt ans que les grandes entreprises ont pris l’habitude de naviguer entre une forte pression et le harcèlement moral, il en résulte une surchauffe qui jusqu’à présent s’est traduite, chez la plupart des gens, par une espèce de colère rentrée et, de temps en temps, quelques mobilisations. Les salariés n’osant plus prendre le risque d’un affrontement frontal par la grève ont du courber l’échine dans l’espoir de garder leur place. Ce qui ne les a pas empêché de faire le lien entre l’ultralibéralisme et ce qu’on leur a fait vivre qui relève de l’immoralité. Avec maintenant un peu de recul tout le monde (ou presque !?) a compris que si autant d’entreprises se sont séparées d’autant de salariés, si depuis une vingtaine d’années les délocalisations se sont multipliées et si de plus en plus de compagnies ont fermées, nous le devons à la financiarisation exacerbée de l’économie. Un mode de fonctionnement qui confirme catastrophiquement ses trois principales lacunes : les limites (très) étroites de sa compétence ; l’aveuglement (persistant) de ses partisans et l’inexistence (coupable) de ses moyens de contrôle. On le voit bien au travers de ces quelques considérations, alors que depuis toujours l’économie était plus ou moins directement au service de l’homme, la financiarisation de l’entreprise a fini par renverser la proposition : dans quelque domaine que ce soit (ou presque), travailler est devenu, d’abord et avant tout, devoir se mettre au service de résultats financiers.
Avant la révolution managériale débutée dans les années quatre-vingt-dix, la primauté au sein des entreprises allait à la production, puis la vente est devenue prioritaire, c’est désormais la rentabilité financière qui est prépondérante. Comme en outre sont maintenant nombreux ceux d’entre-nous qui ont du mal à trouver du sens dans la religion, la patrie, la famille, qui en étaient jusqu’ici largement dispensatrices (qu’on s’en félicite ou qu’on le regrette, les faits sont là), et que par ailleurs le triomphe du pouvoir économique n’a jamais été source de normativité morale, la situation se tend. Elle se tend à un point tel que quelquefois on ne voit plus très bien ce qui pourrait rassembler, et encore moins rassurer, les salariés déboussolés.
Que faire en ces temps du triomphe de l’individualisme ?
Étant donné qu’on ne peut pas revenir en arrière, il est urgent de reconstruire l’entreprise, pas par nostalgie du passé mais parce que l’on tient là l’unique façon de réussir l’avenir, en limitant les risques de burn-out . Et, étant donné que ce n’est pas parce qu’on est un expert dans un domaine ou un autre que l’on est un bon manager, le moment est venu de donner à la maîtrise et aux cadres, non seulement une réelle et suffisante marge de manœuvre mais aussi une formation sérieuse, complète et concrète, aux dix techniques qui fondent (depuis presque toujours) le management efficace d’une équipe au travail :
- la communication interindividuelle ;
- la gestion du changement dans les organisations ;
- la recherche de l’amélioration de la qualité (à ne pas confondre avec la certification) ;
- la délégation de pouvoir ;
- la prise de décision ;
- la négociation interindividuelle ;
- la motivation de l’homme au travail ;
- la conduite de réunion ;
- la prise de parole en public ;
- l’entretien de face-à-face.
Nous savons que face à l’ampleur des dégâts la pédagogie ne résoudra pas tout, loin s’en faut. Mais si l’on n’utilise pas en premier lieu les moyens qui ont depuis longtemps fait leurs preuves, rien ne sera jamais résolu.
D’autant que, non seulement les 100 principales causes de non-qualité de vie au travail sont maintenant répertoriées mais on sait en outre, avec certitude, qu’un management de qualité pallie plus d’une de ces causes. On sait de plus, et aussi avec certitude, qu’il ne suffit pas d’être spécialiste dans un domaine ou un autre pour être un bon manager mais que la Conduite des hommes s’apprend et qu’elle améliore les résultats.
-
Kit complet d’animation d’une Formation à la Conduite des hommes. En vente dans toutes les librairies de France, Belgique et Suisse

![[Citation] La plupart des échecs dans la vie viennent des personnes qui… (Thomas Edison).](https://www.verbiage.fr/wp-content/uploads/2015/01/Edison-150-150x140.jpg)
![[Citation] « Les deux choses les plus importantes n’apparaissent pas au bilan de l’entreprise… (Henry Ford).](https://www.verbiage.fr/wp-content/uploads/2015/03/Henry-Ford250-150x150-150x140.jpg)